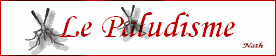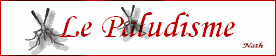M E D I C A L : M E D I C A L :
-
Neuropaludisme
Voir également paludisme
Synonyme : Accès pernicieux, fièvre
pernicieuse
En anglais : pernicious malaria,
severe malaria.
Manifestation grave mais rare,
quelquefois mortelle survenant après une infestation par le plasmodium
falciparum (le plus souvent), parasite transmis par l'anophèle femelle,
moustique responsable du paludisme.
L'accès
pernicieux appelé aussi neuropaludisme (touchant le système nerveux)
est la forme grave du paludisme. En effet le plasmodium falciparum qui
est le parasite transmis par les moustiques femelles de type anophèle,
à l'origine du paludisme, est susceptible d'atteindre le cerveau. Ce
sont les enfants qui en sont le plus souvent atteints. Les femmes
enceintes en zone d'endémie et le voyageur sans immunité anti palustre
(contre le paludisme) sont également susceptibles de présenter cette
pathologie.
Le neuropaludisme se caractérise par un syndrome (ensemble de
symptômes) pernicieux (très graves) dont le début est fréquemment
brutal :
Adynamie (le patient ne bouge plus)
Prostration (affaiblissement extrême des forces musculaires obligeant
le patient à s'immobiliser)
Asthénie intense (grande fatigue)
Collapsus (impossibilité pour certains organes de fonctionner
normalement, c'est le cas entre autres de la circulation sanguine et du
cœur)
Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) à l'origine d'une
déshydratation (perte importante de liquide) entraînant...
Anurie (absence d'urine)
Hyperazotémie (élévation du taux d'azote provenant de la dégradation,
destruction des protéines du patient lui-même, dans le sang)
Sueurs froides
Cyanose (coloration des tissus, de la peau en bleu-violet traduisant la
diminution de l'arrivée de l'oxygène)
Refroidissement intense des extrémités (mains pieds)
Hyperthermie (élévation de la température) importante
Hypoglycémie (diminution du taux de glucose dans le sang)
Anémie sévère
Évolution
Des troubles neurologiques à type de troubles de la conscience et de
convulsions peuvent survenir, ils peuvent aller jusqu'au coma. Au
départ il s'agit de simple tremblements, de délire et d'une fièvre très
élevée. Dans ce cas le pronostic de la maladie est moins favorable.
Le traitement de l'accès pernicieux (qui est mortel le plus souvent)
fait appel à la quinine injectée directement dans la circulation
sanguine par voie intraveineuse en milieu hospitalier. Sans traitement
convenablement conduit, la mortalité est de 20 %. Le patient peut
également présenter des séquelles neurologiques définitives surtout
chez l'enfant.
Révisé le 01/01/2003
       

Malaria et
paludisme sont les deux termes compris partout, et les plus communément
utilisés pour désigner la maladie dont nous parlons. De ces deux
vocables, le premier impose à l’esprit l’idée du mauvais air, l’autre
celle des marais, c’est à dire les deux causes étiologiques invoquées
depuis des siècles pour expliquer les fièvres périodiques que nous
identifions aujourd’hui au paludisme. Il était naturel, étant donné la
fréquence de la maladie en Italie et les nombreuses observations qui y
ont été faites, que la référence au « mauvais air » ait
trouvé son expression dans ce pays. Il semble que ce soit au Moyen Age
que les deux mots mala et aria ont été réunis, en un seul, malaria, qui
ne désignait d’ailleurs pas la maladie mais la cause la provoquant
(47).
Le terme s’est maintenu jusqu’à nos jours en langue
anglaise. D’après les recherches de P.F. Russel (en 1955),
le mot malaria aurait été écrit pour la
première fois « en anglais » en 1740 par
Horace Walpole à l’occasion d’un voyage en Italie et
pour désigner la cause d’une
« mortalité » annuelle et c’est
seulement en 1743 qu’il serait apparu dans un texte
médical italien publié à Rome par F. Jacquier.
Mais le Dictionary of English Language, dans son édition de
1827, ne fait pas encore figurer le mot malaria. Et c’est Macculloch
(1775-1835) qui fut vraisemblablement le premier auteur médical anglais
à utiliser le terme, qu’il déclare emprunter à l’italien, dans son
ouvrage, écrit en 1828, intitulé Malaria ; an essay on the
production and propagation of this poison (51).
Le mot malaria est ici employé dans le sens d’une
substance chimique provoquant la maladie.
Il s’agit là
d’une référence assez précise, par contre, il est difficile de savoir à
quelle date exacte « paludisme » est entré dans la langue
française.

Le
paludisme
Le Dictionnaire
de l’Académie Française par J. B. Coignard en 1694 mentionne bien
marais et « marescage », mais il ne comprend ni
« palus », ni « palud ». Alors que le Dictionnaire
de l’ancienne langue française
par Godefroy (1888) fait dater « palustreuse » de
1485, « paludeux » de 1491,
« palustre » de 1528,
« paludineux » de 1530. Le
Dictionnaire étymologique de Dauzat (1958) indique
1505 pour « palustre ».
Il s’agit
toujours pour chacune de ces expressions soit de ce qui a trait à la
nature du marécage, soit encore de ce qui y vit ou croît (hommes,
plantes). Il ne sera pas question avant longtemps de maladie pouvant
avoir un rapport avec le « palud ».
Ce n’est
qu’aux environ de 1840 que l’adjectif
« paludéen » commence à
apparaître dans la littérature médicale
associé à fièvre ou maladie. Ce n’est en
1851 que le Nouveau Dictionnaire lexicographique et descriptif des
Sciences Médicales et Vétérinaires (Raige-Delorme, Boulet,
Daremberg) inclut « paludéen » avec la définition
suivante :
Paludéen,
adj. (de palus, marais) : qui à rapport aux marais, qui est causé
par les effluves marécageux ; miasmes paludéens ; affections,
fièvres paludéennes.
Le mot
paludéen
n’est admis à l’Académie Française
qu’en 1878 en même temps que son synonyme
« palustre ». Quant au mot
« paludisme », il n’apparaît toujours
pas. Par exemple, il n’existe pas dans le Grand Dictionnaire
Universel de Pierre Larousse de 1874.
En revanche,
« impaludisme » que l’on commence à lire dans les rapports
médicaux et les communications à partir de 1846, est défini en 1873
comme un « état général de l’économie, avec prédisposition aux
affections intermittentes de la rate, amené par les séjours dans les
marais. V. Paludéen. » (Dictionnaire de la Médecine, E.
Littré et Charles Robin, 1873).
Il faudra
attendre 1857, date à laquelle on retrouve le mot paludisme sous la
plume de F. Jacquot, médecin militaire appartenant au Corps
d’Occupation des Etats Romains. Mais pour lui, le terme paludisme
semble toujours (comme impaludisme) se rapporter plutôt à la cause
provoquant les fièvres intermittentes qu’à la maladie elle-même. C’est
ainsi qu’en 1861, J. A. Laure en Guyane, à propos de la fièvre jaune,
dit qu’elle peut être « liée au paludisme ».
En 1867, A.
Verneuil, chirurgien de l’hôpital Lariboisière, parlant au Congrès
international de Médecine de Paris des patients, dit : « ..l’opéré
est (…) imprégné d’un poison comme dans la syphilis, le paludisme, la
diphtérie, les fièvres éruptives et typhoïdes… ».
Et voici le
paludisme inclus, sous ce nom, en tant que maladie parmi d’autres
affections déjà reconnues.
En 1881,
toujours Verneuil, dans une série d’articles publiés dans la Revue
de chirurgie, dit à propos des divers synonymes employés, (fièvre
intermittente, fièvre palustre, paludisme, impaludisme, malaria,
tellurisme), qu’il préfère le terme paludisme comme plus court et plus
clair et parce qu’il est possible d’en tirer le mot paludique qui
s’applique aux personnes et aux choses. Toutefois, en cette même année
1881, dans deux communications à l’Académie des Sciences et à
l’Académie de Médecine, Alphonse Laveran continue d’employer fièvre
palustre et impaludisme.
En 1884
enfin, dans son Traité des fièvres palustres avec descriptions
des microbes du paludisme, Laveran écrivait dans son
introduction :
« Les
mots paludisme, paludique, qui ont été adoptés par Monsieur le
professeur Verneuil (…) me paraissent excellents pour désigner
l’ensemble des troubles morbides produits par les microbes des fièvres
palustres et les maladies qui sont sous le coup de ces troubles
morbides ».
En 1907, il
souhaitait dans son
Traité du paludisme que le mot paludisme soit employé de préférence
à ses nombreux synonymes. Il écrivait : « Le mot
paludisme a été préconisé par Verneuil. (…) Il est devenu familier au
public médical et je l’ai inscrit sans hésiter en tête de ce livre ».
De fait, à
cette date, le mot paludisme était déjà entré dans l’histoire de la
médecine tropicale.
La date
officielle, sanctionnée par les dictionnaires, de l’entrée du mot dans
la langue française est fixée à l’année 1884. Il apparaît dans le Dictionnaire
Encyclopédique de A. Dechambre
Il fallut
toutefois attendre 1920 et la 7° édition du Dictionnaire des termes
techniques de Médecine
par M. Garnier et V. Delamare pour voir accolé au mot paludisme le nom
de A. Verneuil, le chirurgien auquel revient le mérite de l’avoir
préconisé et fait adopté par Laveran lui-même.
H. H. Scott
écrit au sujet de « l’appellation » de la maladie, dans son Histoire
de la médecine tropicale parue en 1939, que le nom de malaria,
utilisé depuis longtemps en anglais est la perpétuation d’une erreur,
car la maladie n’a aucun rapport avec le « mauvais air » et
que l’autre nom paludisme est également une erreur, car il y a des
marais sans paludisme et en beaucoup d’endroits du paludisme sans
marais.

       
|